
Jules Gheude (à droite) avec François Perin dont il a rédigé la biographie
La campagne pour les élections législatives, régionales et européennes du 9 juin 2024 se prépare activement. Qu’est–ce que cela vous inspire en tant qu’observateur attentif de la vie politique belge depuis quelque 50 ans ?
La façon de faire campagne s’est considérablement modifiée avec l’apparition des réseaux sociaux. En 2022, la N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA ont ainsi dépensé quelque 3,5 millions d’euros en publicité sur Facebook et Instagram, soit 72% du montant total dépensé par tous les partis. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les transfuges – celles et ceux qui quittent leur parti pour obtenir mieux ailleurs – et la pêche aux candidats surprises que l’on utilise, en raison de leur notoriété, comme savonnettes pour faire mousser les voix. C’est un procédé que je n’apprécie guère, car il constitue une sorte de mépris à l’égard des militants dits de la base. Et que dire de cette « dynastie familiale », qui privilégie les fils et filles de ? Enfin, le fait que le commissaire européen Didier Reynder se déclare déjà candidat à la fonction de président du Conseil de l’Europe et que le président du Conseil européen, Charles Michel, décide de tirer la liste MR pour les élections européennes ne me paraît pas de nature à réconcilier le citoyen avec la politique. Comme l’écrit le professeur Franklin Dehousse de l’ULg, « l’image de la Belgique ne ressort pas grandie de tous ces cirques carriéristes, qu’on n’avait jamais vus jusqu’ici, de Jean Rey à Marianne Thyssen. » Quant à la prolifération des partis politiques (Hendrik Bogaert et Els Van Ampe viennent d’ajouter « Redelijk Rechts » et « Voor U » à un paysage politique déjà fort chargé), elle ne me paraît pas non plus susceptible de servir la démocratie. Une enquête récente du « Vif » et de « Knack » a d’ailleurs révélé que 51% des Belges estimaient que leur vote ne comptait pas.
Mais quid de ces élections du 9 juin 2924 quant au fond ?
Elles vont revêtir une importance majeure, tant au niveau belge qu’européen. Pour la première fois, en effet, les deux formations flamandes séparatistes, le Vlaams Belang et la N-VA, pourraient réunir la majorité absolue au Parlement flamand. Si, hypothèse nullement fantaisiste, le blocage absolu s’installait au niveau de la constitution d’un nouveau gouvernement fédéral, ces deux formations pourraient en tirer argument pour proclamer l’indépendance de la Flandre. Et un parti comme le CD&V n’y serait certes pas opposé. Je me souviens, en effet, des propos tenus par l’ex-président Wouter Beke en 2007 au journal québécois « Le Devoir » : « Nous voulons une véritable confédération où chacun pourra agir comme il l’entend. Si les francophones n’acceptent pas de lâcher du lest, nous n’aurons pas d’autre choix que l’indépendance. » Difficile d’être plus clair, non ? Au niveau européen, nous aurons une progression importante de l’extrême-droite, qui ne facilitera pas le fonctionnement des institutions. Or, avec la menace d’un retour de Donald Trump aux affaires, l’Union européenne doit se préparer à ne compter que sur elle-même et donc bâtir sa propre défense militaire.
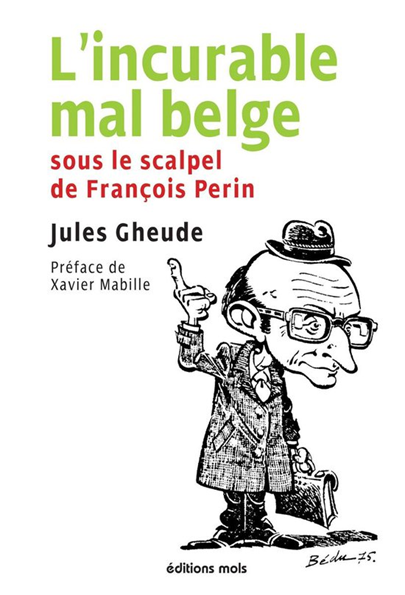
Comment, selon vous, le blocage pourrait-il s’installer en Belgique ?
Par le fait que les responsables francophones ne veulent pas entendre parler de cette réforme confédérale voulue au Nord du pays. Je vous rappelle que l’idée en a été lancée au début des années 90 par Luc Van den Brande, alors ministre-président flamand (CVP) et qu’elle a été avalisée par le Parlement flamand en 1999 (les fameuses cinq résolutions). Les responsables francophones s’accrochent au fédéralisme, refusant d’admettre que la Flandre a cessé d’être une entité fédérée pour se constituer en nation. C’est une évolution irréversible que Manu Ruys avait annoncée avec le sous-titre de son livre « Les Flamands » en 1973 : « un peuple en mouvement, une nation en devenir ».
Bart De Wever s’est dit prêt à prendre la tête d’un cabinet de crise, qui reflèterait les gouvernements des entités fédérées.
Son parti prône ouvertement l’émergence d’une République flamande, donc la fin de la Belgique. Il a donc tout intérêt à ce que la Belgique apporte la preuve de son ingouvernabilité. Un pays qui ne parvient pas à se doter d’un gouvernement est, en effet, un pays qui n’existe plus. J’observe aussi que Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, souhaite qu’un gouvernement flamand se constitue avant celle d’un gouvernement fédéral et qu’il met à l’agenda la scission du pays. Voilà qui n’est pas sans rappeler les propos tenus en août 2009 par Walter Baeten, le président du Comité du Pèlerinage de l’Yser, en présence de Kris Peeters, alors ministre-président flamand ; « Le gouvernement flamand est le seul légitime pour la Flandre. »
Dans le passé, les responsables francophones se sont toujours présentés comme « demandeurs de rien » pour finalement céder en contrepartie d’argent. Ne sera-ce pas encore le cas cette fois-ci ?
La Région wallonne est dans une situation budgétaire intenable, avec une dette qui représente deux fois ses recettes annuelles. Elle a donc besoin d’argent, tout comme la Communauté française d’ailleurs. Mais cette fois, les caisses de l’Etat sont vides… Et la Flandre n’entend plus être financièrement solidaire d’une Wallonie qui, en 43 ans de régionalisation, n’est pas parvenue à opérer son redressement. La faute, selon elle, à une gestion inappropriée, marquée du sceau du PS (à la ministre-présidence wallonne durant près de 40 ans !). Cela étant, la situation budgétaire de Bruxelles est loin, elle aussi, d’être florissante.

Mais quid de la Wallonie si elle devait se retrouver seule, à son corps défendant ?
Pour les ultra-régionalistes, une Wallonie indépendante pourrait fort bien s’en sortir. On se demande bien comment. Les sacrifices à consentir seraient d’une telle ampleur qu’ils entraîneraient une baisse drastique des prestations sociales. « Il en résulterait un climat insurrectionnel » a même déclaré feu le professeur d’économie Jules Gazon (ULg). Le président du PS, Paul Magnette, pense à une association Wallonie-Bruxelles, le fameux WalloBrux. Lors des négociations pour la formation du gouvernement en 2019, il a clairement demandé à Bart De Wever de laisser les francophones poursuivre sous l’appellation Belgique en cas de scission de l’Etat. Le problème, c’est que, selon diverses enquêtes, une majorité de Bruxellois (cela va de 68 à 73,9%) tiennent à leur spécificité et optent pour une Région bruxelloise autonome.
Reste la réunion à la France, que vous prônez, mais pour laquelle les Wallons ne semblent pas chauds. Ils ne souhaitent pas, comme ils disent, être des citoyens de seconde zone…
Ce sont surtout les responsables wallons tous azimuts – partis, mutuelles, syndicats – qui craignent pour leur survie. Il faut ici mettre les choses au point.
La caricature de l’Etat français jacobin est dépassée. L’article 1er de la Constitution française précise bien que l’organisation de la République « est décentralisée ». Une assimilation de la Wallonie à la France ne pourrait être envisagée du jour au lendemain, en raison des différences qui existent dans certains secteurs. C’est pourquoi Jacques Lenain, un ex-haut fonctionnaire français aujourd’hui retraité, suggère l’adoption d’un statut particulier, qu’il dénomme « intégration-autonomie » et qui est de nature à rassurer les responsables wallons qui craignent de perdre des plumes dans l’aventure. Interrogé à cet égard, le constitutionnaliste français Didier Maus confirme en effet : « Il serait parfaitement possible de créer un titre spécial « De la Wallonie » qui contiendrait une mini-constitution sur mesure pour cette région. Il en découle que, sur le fondement de cette mini-constitution, il serait parfaitement réalisable de conserver en l’état, au moins pour l’essentiel, et pour une durée à déterminer, le droit belge du travail, celui de la sécurité sociale, et certains droits « connexes », des pans du droit fiscal, le droit des affaires, du commerce, etc. La région wallonne, et aussi la région bruxelloise si la question était posée, conserveraient les compétences qui sont aujourd’hui les leurs, y compris le système éducatif, avec l’enseignement supérieur. Ce ne serait pas une difficulté de faire de la sorte puisque il en est déjà ainsi, même si c’est avec moins d’ampleur, dans certains territoires français, qui, selon les cas, disposent d’une sécurité sociale propre (Polynésie, Calédonie,…), d’un droit du travail propre (même s’il est largement copié sur celui de la métropole), de nombre de dispositifs fiscaux particuliers, et d’autres régimes spéciaux dans divers domaines (en Corse comme en Outre-mer). » Bref, la Constitution française est d’une grande souplesse et pourrait permettre à la Wallonie de préserver l’essentiel de ses acquis (institutions et compétences). Pour ce qui concerne l’ex-droit fédéral belge, il pourrait être aussi conservé en grande partie et placé sous l’autorité du législateur français. Seul le nombre d’élus wallons à l’Assemblée nationale serait inférieur à ce qu’il est aujourd’hui à la Chambre.
Encore faut-il que la population française soit d’accord…
Un sondage Ifop/France-Soir réalisé en 2010 a révélé que 66% des Français (cela va jusqu’à 75% dans les régions frontalières) étaient ouverts à un rattachement de la Wallonie.
Mais depuis, la situation budgétaire de la France s’est sensiblement dégradée. Quid de l’impact financier ?
L’économiste Jules Gazon a étudié ce point : « Le PIB de la France « augmentée » de la Wallonie serait égal à 24 fois le PIB wallon. L’amplitude des effets en termes de déficit public et de dette publique par rapport au PIB serait divisée par 24. Elle serait marginale. » Quant à Jacques Attali, l’ex-conseiller du président François Mitterrand, il écrivait sur son blog, le 9 septembre 2008 : « Le prix à payer pour la France serait sûrement plus faible que ce que cela lui rapporterait. C’est un beau débat. Qu’il commence ! »
Reste donc à vaincre la résistance wallonne…
Lorsqu’ils seront placés devant le fait accompli et qu’ils constateront la profondeur du gouffre à leurs pieds, les Wallons comprendront très vite où se situent leurs intérêts. Je ne me fais aucun souci à cet égard. Je tiens ici à rappeler les propos tenus par le général de Gaulle au professeur Robert Liénard de l’Université de Louvain dans les années 60 : « J’ai la conviction que seule leur prise en charge par un pays comme la France peut assurer l’avenir à vos trois à quatre millions de Wallons. »
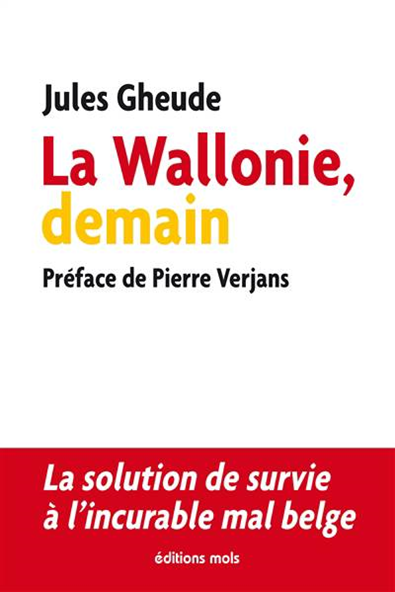
En maintenant la Wallonie telle qu’elle est via ce statut d’intégration-autonomie, peut-on s’attendre à ce qu’elle soit mieux gérée ? On retrouvera, en effet, le même personnel politique…
Il serait stupide de penser que la Wallonie n’aurait aucun compte à rendre quant à l’effort pérenne de solidarité nationale dont elle bénéficierait. L’Etat français, qui s’arroge en particulier le pilotage et le contrôle des dépenses sociales, veille à un traitement équitable des populations. On peut donc présumer qu’il poserait comme préalable l’engagement des responsables wallons sur des réformes de fond susceptibles d’aboutir à une diminution progressive des concours financiers en cause (régulation des effectifs d’agents publics, réforme et activation des prestations de chômage, etc.) Cette exigence légitime de rigueur devrait d’ailleurs satisfaire les Wallons qui attendent plus d’efficacité de la part de leurs institutions. Pour autant, cela ne remettrait jamais en cause l’existence même des services publics et des prises en charge sociales en Wallonie, ainsi que leur équivalence en niveau avec les services et prestations homologues assurés pour la France entière.
