Jules Gheude, essayiste politique (1)
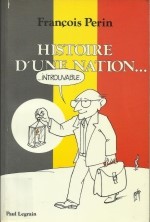
Dans une carte blanche publiée sur le site de « Doorbraak » le 4 août, Tony Van de Calseyde et Frédéric Amez, respectivement président et vice-président de B Plus (« pour une Belgique fédérale, rénovée et solidaire »), expliquent que leur mouvement voit plus loin que la pure politique partisane. Ils contestent notamment la présentation de la Belgique comme un Etat artificiel, né en 1830 d’un trait de plume diplomatique :
Les territoires que nous appelons aujourd’hui Belgique ont bien une histoire commune qui remonte au 15e siècle et aux ducs de Bourgogne. Seule la principauté de Liège fait ici exception. Depuis les guerres de religion et l’indépendance des provinces du Nord (les Provinces unies) au 17e siècle, les Pays-Bas du Sud ou catholiques ont toujours été considérés comme un seul territoire, aussi bien par les Espagnols et les Autrichiens que par les Français qui furent les seuls à conquérir notre région par la violence au lieu de la succession habituelle d’une dynastie à l’autre.
Retour donc au mythe de la prédestination belge, soigneusement entretenu par certains historiens, tels que Henri Pirenne et Godefroid Kurth.
Dans son « Histoire d’une nation introuvable » (Ed. Paul Legrain, 1988), François Perin a tenu à remettre les pendules à l’heure, fustigeant l’attitude trompeuse de ces historiens qui sont à la base de tout l’enseignement de l’histoire dans toutes les écoles belges du XXe siècle et qui ont mêlé de toute évidence histoire et patriotisme. Ils ont donc vu dans le passé ce qui n’y était pas pour fortifier le sentiment de fidélité des citoyens à l’Etat, en modelant leur esprit à un âge où il est relativement aisé d’imprimer un moule dans une jeune mémoire. (…) Pour frapper de crainte révérentielle les citoyens d’aujourd’hui, mille ans ne sont pas de trop pour trouver à un Etat une ancienneté vénérable.
Et François Perin de passer au crible la façon dont ces historiens « traditionnels » ont interprété les faits :
Prenons par exemple le dramatique XVIe siècle. Godefroid Kurth, fervent catholique à la manière intransigeante de la fin du XIXe siècle, n’aime guère rappeler que les comtés de Flandre et le duché de Brabant étaient largement ralliés à la Réforme ; les catholiques eux-mêmes ne supportaient guère l’intolérance espagnole ; ces deux Etats féodaux avaient rallié l’Union d’Utrecht, berceau des Provinces unies néerlandaises et ils n’en ont été arrachés que par la force des armées espagnoles avec une cruauté sans nom. Or, Godefroid Kurth fait de la religion catholique le critère historique de la Nation belge !
La principauté de Liège gêne Henri Pirenne. La maison de Bourgogne y a été haïe. Or, Pirenne porte les ducs de Bourgogne aux nues. L’histoire de Liège est reléguée dans son œuvre au rang subalterne d’histoire locale pendant que l’histoire du comté de Flandre fait partie de l’histoire nationale (belge).
Ces deux auteurs classiques, qui ont dominé tous les manuels et cours d’histoire pendant un siècle, refusent de qualifier la monarchie espagnole des XVIe et XVIIe siècles de régime de domination, sous prétexte que ses rois étaient, pour l’un, des rois catholiques, pour l’autre dans la filiation légitime des ducs de Bourgogne. Seule la période française est qualifiée de domination.
Godefroid Kurth, fils d’un Allemand et d’une Arlonnaise, a la France en aversion, surtout celle de la République laïque.
Fervent bourguignon, royaliste et légitimiste, Henri Pirenne se réjouit que la monarchie des Saxe-Cobourg a été conçue (à Londres) pour maintenir la Belgique à bonne distance de la France.
La période française doit donc être qualifiée d’une façon péjorative par ces auteurs.
Dans son discours de 1899, intitulé « La Nation belge » et prononcé à la distribution des prix aux lauréats du concours universitaire et du concours de l’enseignement moyen, Henri Pirenne fait le constat suivant : A la fin du Moyen Age, le temps était venu, en effet, où les divers territoires des Pays-Bas devaient nécessairement s’unir en un même corps d’Etat. L’œuvre des ducs n’est pas une création artificielle. Elle est la conséquence naturelle de toute notre histoire au Moyen Age. Ils ont unifié ce pays que la victoire de 1302 avait arraché à la France.
Ainsi, pour Henri Pirenne, s’arracher à la France est la condition d’existence de la Belgique.
Or, explique François Perin, la victoire des communiers flamands de 1302, dont les Flamands font aujourd’hui un symbole du nationalisme flamand contemporain, était surtout une victoire des métiers contre les praticiens des villes flamandes qui, dans cette lutte sociale, avaient trouvé opportun de s’allier avec les forces du suzerain français. Double symbole actuel, puisque le mouvement flamand fut principalement dressé contre la bourgeoisie belgo-flamande francophone.
Pour François Perin, la réalité est plus complexe que les simplifications mythiques : Dans cette fameuse bataille de Courtrai, les chevaliers de Philippe le Bel n’étaient pas tous français. Il y avait aussi des Brabançons, des Hennuyers et même des Flamands. Contre eux, on trouve entre autres des mercenaires wallons de Guy de Namur, appuyant les métiers flamands contre leurs propres praticiens !
Dans son « Histoire de Belgique », Henri Pirenne s’enthousiasme en constatant : Désormais l’œuvre des siècles est accomplie. L’union à laquelle nos provinces tendaient inconsciemment depuis longtemps se réalise.
Mais François Perin s’empresse de réfuter ce jugement de valeur : On a vu que les siècles n’avaient rien accompli du tout. Qu’importe ! Le patriote visionnaire pénètre jusque dans l’inconscient collectif de « nos » provinces pour y déceler une tendance à l’union. (…) En réalité, cette union sera l’œuvre d’une dynastie de princes ambitieux et sans scrupules, rivale de celle du roi de France, et qui s’imposera par la force sans avoir jamais été souhaitée par leurs futurs sujets.
Dans son discours de 1899, Henri Pirenne reconnaît d’ailleurs lui-même que les ducs de Bourgogne n’ont pas eu d’idéal national ; ils n’ont agi que pour la grandeur de leur maison. Leur politique s’explique exclusivement par leurs intérêts dynastiques.
On ne peut mieux dire.
Et François Perin de conclure : Pirenne est un monarchiste de principe. Il n’est de grandeur que des princes. Il n’y a de légitimité constitutionnelle que dans le principe d’hérédité. Tout ce qui est dans la descendance des ducs de Bourgogne est légitime à ses yeux, quelle que soit la conduite des princes à l’égard de leurs Etats. Ce sont nos « princes naturels ». (…) Légitimiste jusqu’à l’absurde, il ne tient pour valable que le principe d’hérédité, c’est-à-dire le principe le plus arbitraire et le plus capricieux du droit ancien de l’Europe. Les violations des chartes et franchises, les répressions cruelles, les lourds prélèvements fiscaux n’ôtent pas, à ses yeux, aux despotes du passé leur légitimité constitutionnelle. Il dénoncera comme étant une expression erronée les termes de « domination espagnole ». Il n’y a pas pour lui « domination » lorsqu’il y a légitimité par voie d’hérédité.
Il faut cesser de travestir les faits historiques et voir la réalité telle qu’elle est.
Née en 1830, La Belgiquen’a jamais constitué un ensemble harmonieux, que ce soit sous la forme unitaire ou fédérale. Elle n’a plus aucun avenir dans la mesure où la Flandre a fini, au terme d’un long et opiniâtre combat, à s’ériger en Nation propre.
(1) Dernier livre paru : « La Wallonie, demain – La solution de survie à l’incurable mal belge » (Ed. Mols, 2019).
